Une étude sur l’obésité menée sur 800 000 personnes remet en question une théorie historique
Une étude génétique menée à Nancy sur plus de 800 000 personnes remet en cause la théorie du « gène économe », longtemps utilisée pour expliquer l’obésité. Ces résultats ouvrent de nouvelles perspectives pour mieux comprendre et traiter certaines formes de la maladie.

Une vaste étude génétique menée par le professeur et directeur de l’unité nutrition, génétique et exposition aux risques environnementaux de l’INSERM David Meyre et sa doctorante Sandra El Kouche, invalide la fameuse théorie du « gène économe » , qui a longtemps dominé les explications scientifiques sur l’obésité et le diabète.
Une découverte qui change notre regard sur l’histoire de nos gènes, et ouvre de nouvelles perspectives médicales.
La vieille théorie qui avait marqué la recherche
En 1962, le médecin américain James Neel formule une hypothèse devenue célèbre : la théorie du « gène économe » .
L’idée paraît simple et logique. Dans un monde où la famine était fréquente, certains individus survivraient mieux parce que leur organisme savait stocker de la graisse. Ces « bons stockeurs » transmettaient donc davantage leurs gènes aux générations suivantes. Mais dans nos sociétés modernes, caractérisées par l’abondance alimentaire et la sédentarité, ces gènes hérités deviendraient un handicap, favorisant l’explosion de l’obésité et du diabète de type 2.
Pour appuyer sa théorie, James Neel s’était notamment appuyé sur l’exemple des Indiens Pimas d’Arizona, qui, après être passés d’un mode de vie traditionnel à une alimentation occidentale, ont connu une flambée d’obésité et de diabète.
C’est cette théorie que David Meyre et Sandra El Kouche remettent en question.
Une hypothèse séduisante mais jamais prouvée
Depuis plus de 60 ans, la théorie du gène économe alimente les débats scientifiques. « La moitié de la communauté y croyait, l’autre moitié la rejetait. Mais personne n’avait vraiment de données massives pour trancher » , explique le professeur Davis Meyre.
Ce flou commençait à l’agacer : « Je travaille sur la génétique et l’obésité depuis 2001, et je me suis dit qu’il était temps d’apporter une réponse claire. » Avec sa doctorante, Sandra El Kouche, il se lance alors dans une étude d’une ampleur inédite.
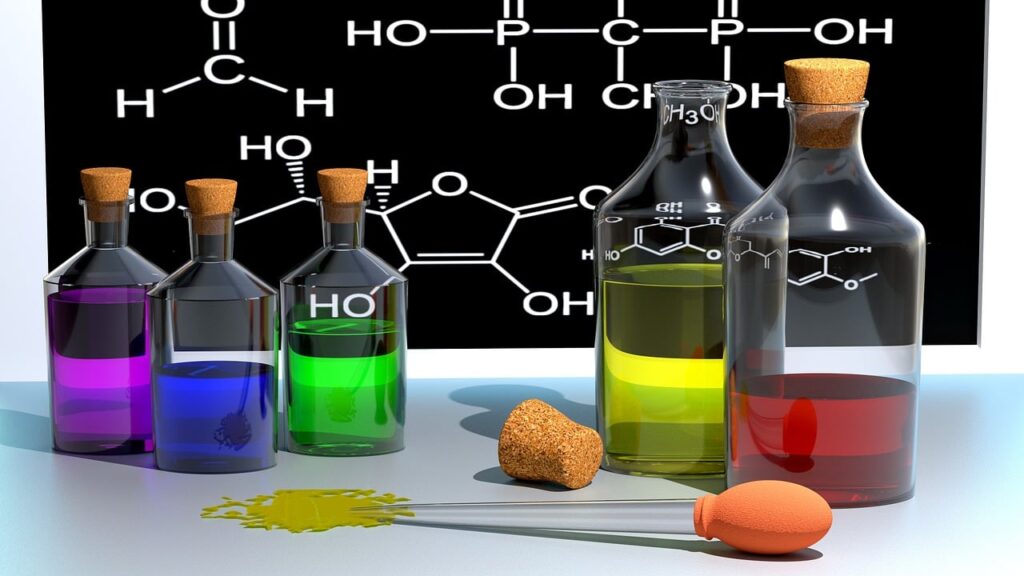
800 000 génomes passés au crible
Grâce à une base de données publique, l’équipe a analysé les exomes et génomes de plus de 800 000 personnes, issues de sept grands groupes ethniques (Européeens, Africains, Latino-Américains, Moyen-Orientaux, Asiatiques de l’Est et du Sud, Juifs ashkénazes).
L’attention s’est portée sur 73 gènes déjà connus pour leur rôle dans des formes d’obésité rares :
- 65 liés à l’obésité syndromique, qui associe obésité sévère et autres troubles (retard mental, malformations, etc.) ;
- 8 liés à l’obésité monogénique, où le principal symptôme est une faim excessive et une prise de poids très rapide.

Des résultats sans appel
Contrairement à ce que suggérait James Neel, les chercheurs n’ont trouvé aucune preuve que ces mutations étaient avantageuses dans le passé.
- Pour les gènes liés à l’obésité syndromique, les mutations présentent même une signature négative de sélection naturelle. Autrement dit, elles étaient plutôt désavantageuses et éliminées au fil des générations.
- Pour les gènes de l’obésité monogénique, aucune trace non plus d’un avantage évolutif. Leur présence est compatible avec un modèle neutre, c’est-à-dire dû au hasard et non à une pression de l’environnement.
- Enfin, les chercheurs ont exclu l’idée d’une sélection naturelle « balancée » (des mutations tantôt avantageuses, tantôt défavorables selon le contexte).
« En clair, nos résultats montrent que ces gènes ne sont pas des reliques d’adaptation aux famines. Leur distribution actuelle relève plutôt de la dérive génétique, du hasard de l’histoire des populations humaines » , résume David Meyre.
Obésité : une équation à 50/50
Ces conclusions ne signifient pas que les gènes n’ont rien à voir avec l’obésité. Bien au contraire. « L’obésité, c’est 50% génétique et 50% d’environnement » , rappelle le chercheur.
D’un côté, il existe bien des différences individuelles héritées : certaines personnes sont biologiquement plus enclines à stocker l’énergie que d’autres. Mais de l’autre, l’environnement moderne (aliments transformés, riches en sucres et en graisse, sédentarité) joue un rôle majeur tout aussi détérminant.
Bonne nouvelle : cela veut dire qu’un profil génétique à risque n’est pas une formalité. « Nous avons montré que certains gènes augmentent légèrement le poids, mais que l’effet disparaît complètement chez les personnes qui pratiquent une activité physique intensive » , illustre David Meyre.

Un impact médical direct
Au-delà du débat théorique, cette étude a des retombées concrètes. Car certaines formes génétiques d’obésité sévère peuvent désormais être traitées.
« Nous avons aujourd’hui des médicaments ciblés qui corrigent directement le défaut génétique. Les patients peuvent perdre jusqu’à 70 kilos sans rien changer à leur mode de vie, simplement parce que la cause biologique est corrigée » , souligne le professeur.
C’est pourquoi l’équipe de Nancy développe des programmes de dépistage génétique en milieu hospitalier. Connaître les mutations présentes dans une population permet de mieux décider quand proposer un test et un traitement adapté.
Autre constat frappant : selon les groupes ethniques, la fréquence de certaines mutations génétiques peut varier jusqu’à être six fois plus élevée d’une population à l’autre. D’où l’importance d’avoir des données génétiques diversifiées pour développer une médecine adaptée à chaque patient.
Et maintenant ?
L’étude ne ferme pas la porte à de nouvelles recherches. « Nos résultats concernent sept groupes majeurs, ce qui représente des milliards de personnes. Mais nous n’avons pas encore étudié certaines populations spécifiques, comme les Pimas, les habitants des îles du Pacifique ou les Bédouins des déserts. Ces contextes extrêmes pourraient apporter d’autres enseignements » , précise David Meyre.
L’équipe veut aussi explorer une autre question : si notre génome ne s’est pas adapté aux famines du passé, pourra-t-il s’adapter à la suralimentation chronique du présent ? Rien n’est moins sûr, préviennent les chercheurs.
Malgré la complexité du sujet, le professeur insiste sur une idée forte : la génétique ne condamne pas. « Oui, il existe des gènes à risque, mais aussi des gènes qui favorisent la minceur. Et surtout, les gènes interagissent avec notre mode de vie. Un environnement favorable peut compenser une prédisposition.«
À l’avenir, l’objectif est clair : développer des programmes personnalisés combinant génétique, prévention et traitements pour mieux lutter contre l’obésité.
Léa CANET
